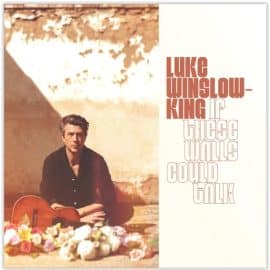| Americana, Rhythm 'n' Blues |

En dépit de son moniker de Motor City, Detroit n’a jamais été fichue de léguer son nom à la moindre berline. Non loin d’elle, Cadillac, Michigan, y est pourtant parvenue, et c’est précisément de là que nous vient Luke Winslow King. Avec une dégaine à rendre verts de jalousie maris et boy-friends dès qu’il traverse le moindre hall de gare ou d’hôtel, il n’est par contre certes pas un grand chanteur, au sens où on peut l’entendre d’un Van Morrison, d’un Ray Charles ou d’un John Fogerty. Mais à l’instar de J.J. Cale ou Bob Dylan, il compense en émotion ce dont la nature l’a privé de puissance. Cet album (son septième à ce jour) le campe dans un registre americana où le semi-Tex-Mex (“Leaves Turn Brown”) côtoie des racines gospel (‘”Slow Sunday June”) et blue eyed soul (“Honeycomb”), tout en ne dédaignant pas le bon vieux rhythm n’ blues vintage de la Crescent City où il vécut quinze ans durant (“Love At First Sight” et la plage titulaire, distincte du quasi-homonyme signé Little Milton). Lui-même guitariste, Luke est flanqué à sa dextre d’un fieffé spadassin, en la personne du dénommé Roberto Luti, dont les saillies au bottleneck brûlant perforent souvent le plafond de nacre. Le Reverend Charles Hodges en personne (pilier des studios Royal de Memphis) gratifie plusieurs plages de son incomparable Hammond B3, tandis que les frères Barnes (Chris et Courtney) y prodiguent de soulful backing vocals. Cette joyeuse bande se permet même de ressusciter l’esprit du Dylan de “Desire” et du Clapton de “No Reason To Cry” (quand ce dernier exauçait enfin son fantasme d’intégrer le Band de Danko, Manuel, Helm, Hudson et Robertson) sur “Don’t Tell Me I Don’t Love You”, ainsi que celui du J.J. Cale de “Troubadour” sur le voodoo-snake “Watch Me Change” et le luminescent “Lissa’s Song”, tous deux zébrés d’une pétrifiante slide à la Ry Cooder. Quand ils font mine de dévider une comptine folk telle que “Winds Of Aragon”, ils ne peuvent s’empêcher de la faire déraper à mi-parcours en hymne pour stadiums et college radios, façon John Hiatt et Mellencamp, à grands coups de roulements et de power-chords seventies. Dans ce registre, “Have A Ball” sonne comme si Guy Forsyth se piquait de botter le cul de Lenny Kravitz, tant la slide fumante de Luti y débite l’atmosphère à la feuille de boucher, pendant que le drum-kit de Christopher Davis semble sur le point d’exploser sous ses ruades. Pétri d’un savant dosage équilibrant la finesse du songwriting et l’incandescence du kérosène, un album autant hanté par le fantôme d’Eddie Hinton que par celui de Duane Allman… Wow!
Patrick DALLONGEVILLE
Paris-Move, Blues Magazine, Illico & BluesBoarder
PARIS-MOVE, December 28th 2022
::::::::::::::::::::::::::::::
https://www.youtube.com/watch?v=8au-KrA5snU