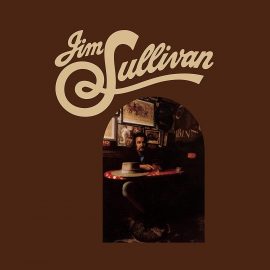| Americana |
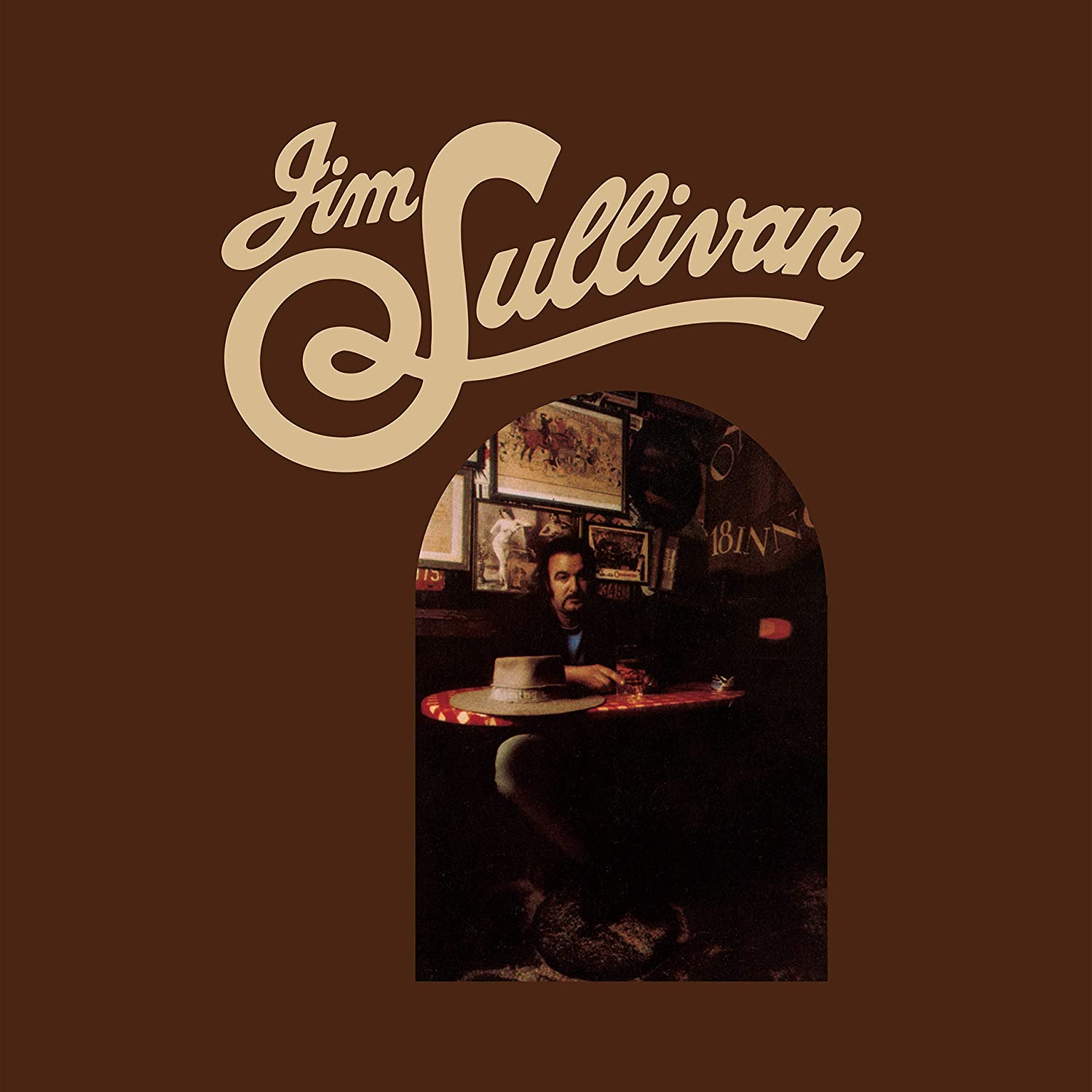
Chapitre deux (et presque déjà la fin) de la courte mais ô combien énigmatique saga discographique du regretté Jim Sullivan. Résumons brièvement l’épisode précédent: avec le soutien de supporters aussi généreux qu’inexpérimentés sur le plan promotionnel, cet escogriffe (dont les quelques portraits évoquent un croisement improbable entre David Crosby et Roberta Muldoon) a pu réaliser son rêve: enregistrer enfin un plein album de ses propres compositions. En cette fin des remuantes sixties, le climat californien post-hippie célébrait justement les valeurs introspectives de singers-songwriters tels que Jackson Browne, Joni Mitchell et James Taylor, et le moment semblait idéal pour y tenter sa chance à son tour. Las, le titre de cet “U.F.O.” devait s’avérer prémonitoire, puisque depuis la critique avisée jusqu’au grand public, personne ne sembla devoir en remarquer le moindre passage, et que les quelques dizaines d’exemplaires qui s’en écoulèrent alors le furent principalement par le truchement infamant des bacs à soldes. Ruminant sa déception, Jim s’était remis à écumer les clubs de la baie à la tête de son propre trio acoustique (parfois même réduit à un simple duo, alternant entre le guitariste Ed Carter et le bassiste Jim O’Keefe) quand, contre toute attente, la chance décida de lui repasser les plats. Depuis sa luxueuse propriété, Hugh Hefner, célèbre patron du magazine Playboy, se piqua soudain d’adjoindre à son empire une branche discographique, fondant ainsi en 1972 Playboy Records. À la recherche d’artistes susceptibles d’étoffer son catalogue naissant, un de ses rabatteurs lui présenta alors un Sullivan aussi pataud que velléitaire, et l’homme à la pipe (sans jeu de mot intentionnel) s’en laissa suffisamment conter pour le signer derechef. À la tête d’un sextette de requins aguerris (et avec le renfort d’une section de cuivres incluant Chuck Findley, Jim Horn et Tom Scott), le producteur Lee Burch semblait déterminé à tirer le meilleur parti de ces sessions d’enregistrement, qui se tinrent aux studios A&M de Hollywood. Outre une nouvelle version du “Sandman” qui concluait son précédent album, Jim Sullivan y livrait une dizaine de nouvelles compositions. Il est évident dès le “Don’t Let It Throw You” introductif que les errements de son prédécesseur relevaient du passé: la production et les arrangements (nettement plus subtils) de Jim Hughart, qui tenait aussi la basse, orientaient désormais la verve de Jim vers ce que l’on ne nommait pas encore les prémisses d’une americana bon teint. Et d’emblée, sur les trois premiers titres, le magistral picking de Sullivan sur sa douze cordes étincelait comme jamais. Si la plage d’ouverture oscillait entre les Byrds d'”Easy Rider” et le “Everybody’s Talking” de Fred Neil (tel qu’adapté par Nilsson pour la B.O. de “Macadam Cowboy”), les tendres “Sonny Jim”, “Tea Leaves” et “I’ll Be Here” s’inscrivaient pour leur part dans la ligne des grands Jim Croce et Gene Clark. Avec son piano bastringue et ses cuivres ragtime, la nouvelle version de “Sandman” l’apparentait au J.J. Cale contemporain de “Naturally” (de même que “Lonesome Picker”, dans une veine plus country), tandis que les plus appuyés “Biblical Boogie (True He’s Gone)”, “Tom Cat” et “You Show Me The Way To Go” évoquaient davantage Tony Joe White (quand ce dernier enregistrait à Nashville durant sa période Monument, sous la houlette du grand Billy Swan et avec le renfort de la Muscle Shoals crew). Les poignants “Amos” (portrait d’un musicien aspirant à une reconnaissance qui ne viendrait sans doute jamais) et “Plain To See” (proclamant la désillusion d’un homme préférant quitter sa compagne plutôt que de lui infliger sa propre précarité, sur un bossa beat cuivré et ironiquement enjoué) accusent une tragique propension prémonitoire. Dans l’histoire du rock, on ne compte plus les artistes ayant asséné dès leur premier album des coups de maître insurpassables, mais en ce qui concerne Jim Sullivan, ce fut assurément le cas de son second essai. Un classique intemporel, qui ne connut hélas (et fatidiquement) jamais de suite.
Patrick Dallongeville
Paris-Move, Blues Magazine, Illico & BluesBoarder
PARIS-MOVE, January 28th 2021