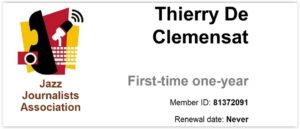| Jazz |
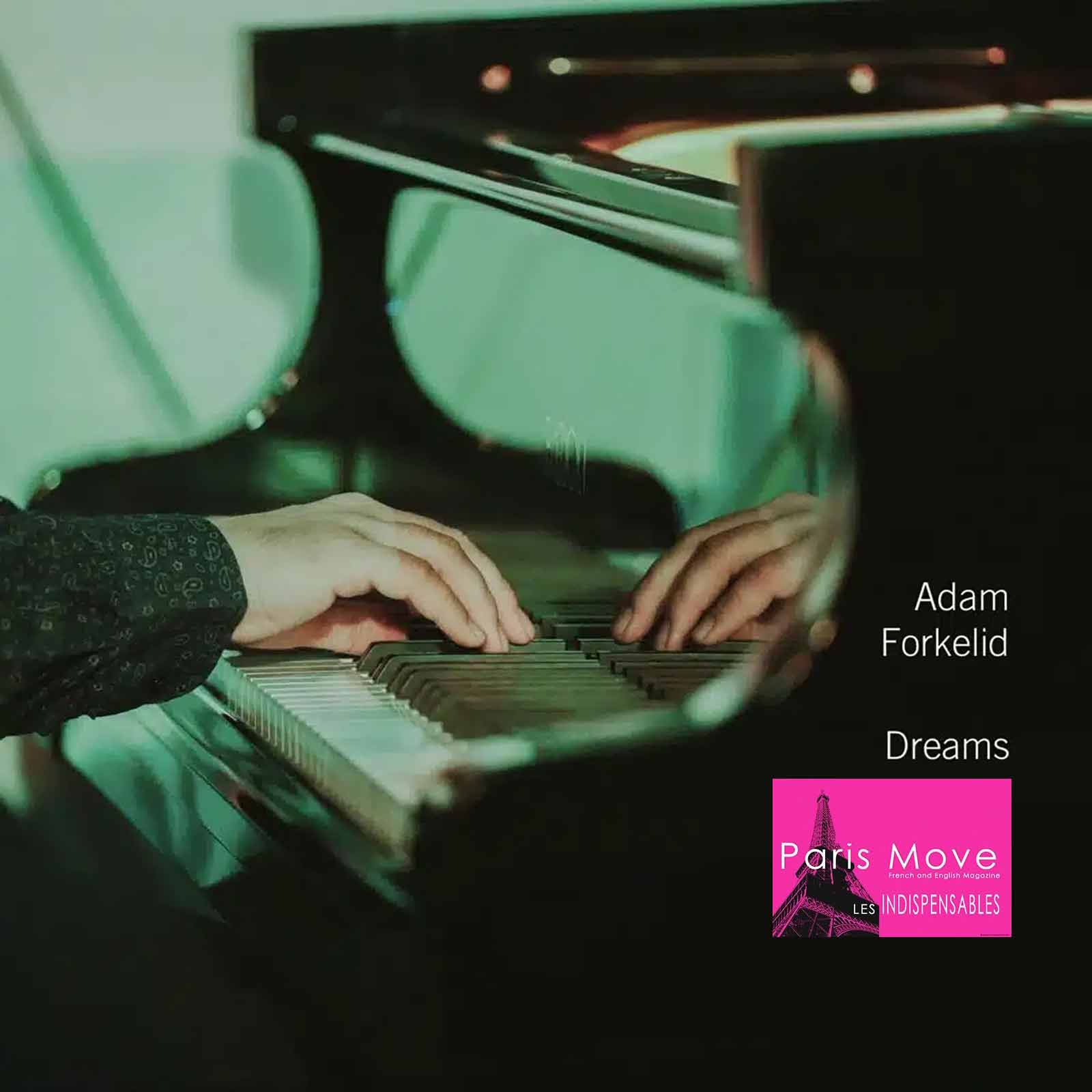
Adam Forkelid et l’art du retour aux principes premiers.
Dans le paysage contemporain du piano jazz, Adam Forkelid occupe une position à la fois singulière et étrangement sous-estimée en dehors de l’Europe. Depuis deux décennies, il est une figure essentielle de la scène scandinave, collaborant avec des artistes aussi prestigieux que Maria Schneider ou Nils Landgren, et bâtissant une carrière marquée par la constance plus que par le spectaculaire. Son dernier album en solo, enregistré dans une salle intime de Stockholm devant cinquante auditeurs à peine, est peut-être celui qui révèle pleinement son art au monde entier.
Lorsque j’écrivais sur Forkelid il y a quelques années, je le décrivais comme «la synthèse musicale parfaite entre Joe Zawinul, du moins dans sa carrière de pianiste solo, et Wayne Shorter.» L’affirmation pouvait sembler audacieuse, mais ce nouvel album en apporte une preuve éclatante. Ce qui manquait jusqu’ici dans sa discographie, c’était une déclaration en solo, un disque dépouillé de l’interaction d’ensemble, où la voix du pianiste, son sens de l’espace et son architecture de pensée puissent se déployer sans fard. Ce vide est désormais comblé, et le résultat n’est pas seulement le portrait d’un artiste à l’apogée de ses moyens, mais aussi une méditation sur ce que peut signifier le piano jazz en solo au XXIe siècle.
La tentation est grande, et peut-être inévitable, de rapprocher Forkelid du lumineux Dancing on the Water de Bob James. Les deux œuvres sont baignées d’influences classiques, des compositions façonnées par une conscience de la forme et une attention à la clarté de l’intention. Toutes deux dégagent une pureté, une sérénité de ligne qui évoquent un retour aux sources. On y entend, au-delà du jazz, l’écho de la musique savante européenne : contrepoint, développement motivique, suggestion d’un choral dissimulé sous l’improvisation. Chez Forkelid comme chez James, on retrouve ce refus de flatter l’auditeur, ce refus d’édulcorer la complexité au nom de l’accessibilité. Et pourtant, paradoxe, la musique reste accueillante, presque irrésistible. Les catégories, jazz, classique, musique de chambre contemporaine, s’effacent. Ce qui demeure, c’est l’élégance.
Les six pièces de Forkelid ne sont ni des miniatures de studio polies, ni des concertos démesurés. Elles s’apparentent plutôt à des études, explorations d’une idée centrale, variations inventées en temps réel. Les jeunes pianistes les aborderont comme autrefois on se plongeait dans les œuvres solos de Keith Jarrett ou de Paul Bley: non pour les imiter, mais pour comprendre la logique interne avant de trouver leur propre chemin. Car, malgré son lyrisme, la musique de Forkelid reste rigoureuse, voire obstinée. Elle impose sa trajectoire, équilibre poésie et structure, séduction et résistance.
Cet équilibre plonge ses racines profondes. Forkelid est, en un sens, l’héritier de deux traditions: celle de la musique européenne, avec son exigence de forme et de discipline, et celle du jazz américain, où improvisation, swing et blues constituent l’étincelle première. Dans son jeu s’installe un dialogue entre ces mondes. On y entend parfois l’ombre du Köln Concert de Jarrett, cette impression d’un improvisateur suspendu entre méditation et révélation — mais aussi la clarté harmonique de Bill Evans, l’abstraction lyrique de Wayne Shorter, et, par instants, l’angle vif de Thelonious Monk. Pourtant, Forkelid refuse les comparaisons faciles. Il ne reprend pas un langage, il le reconfigure pour une époque où les frontières entre les genres s’effacent chaque jour un peu plus.
La singularité de cet album tient aussi à ses circonstances. Par une soirée d’octobre 2024, Forkelid s’est assis devant son Fazioli F278 de prédilection, au Krematoriet, salle stockholmoise d’à peine cinquante places. Sans programme établi, seulement des fragments, des esquisses, des lignes floues, il s’est laissé guider par l’atmosphère et par les visages présents. Le concert s’est déroulé comme une rêverie partagée, une communion entre l’artiste et son public. Quatre des six morceaux sont entièrement improvisés, un autre est né de la réminiscence d’un enregistrement téléphonique, et le dernier revisite Turning Point, œuvre pour quatuor sortie la même année. Le résultat est volontairement imparfait: mouvant, exploratoire, musique découverte en temps réel, fragile et irrépétable.
Or, ce genre d’expérience se traduit rarement bien sur disque. L’attrait de l’improvisation en solo réside précisément dans son éphémérité: cette conscience qu’une phrase jouée ne se rejouera jamais, que la résonance d’une salle appartient à une nuit unique et à un auditoire précis. Pourtant, l’enregistrement de Forkelid parvient à préserver cette aura. L’auditeur ferme les yeux et se transporte parmi les cinquante privilégiés de cette soirée, avec peut-être un pincement d’envie. Pour nous qui sommes de l’autre côté de l’Atlantique, il est tentant d’espérer que Forkelid vienne proposer cette forme de concert aux États-Unis, où l’appétit pour les musiques audacieuses, insaisissables, est plus fort que jamais.
Cet album rappelle une vérité essentielle: Adam Forkelid n’est pas seulement un pianiste talentueux, mais l’une des voix majeures de sa génération. À une époque où tant de musique est aplatie par les algorithmes, calibrée pour les plateformes de streaming et réduite à simple fond sonore, Forkelid affirme l’inverse: la musique comme concentration, comme attention, comme forme de vie. Son œuvre nous rappelle que l’art n’est pas ornemental, mais nécessaire.
L’histoire du piano jazz est, à bien des égards, l’histoire d’une négociation entre liberté et structure, individualité et tradition, de la précision compositionnelle de Jelly Roll Morton à la fougue be-bop de Bud Powell, de l’impressionnisme harmonique de Bill Evans à l’ampleur improvisée de Jarrett. Forkelid s’inscrit dans cette continuité, non pas comme un disciple, mais comme un contributeur qui trace son propre territoire. Son disque est à la fois un hommage à cette lignée et un discret défi lancé pour l’étendre.
S’il est une seule certitude que cet enregistrement impose, c’est bien celle-ci: Adam Forkelid doit désormais être reconnu comme l’un des musiciens les plus importants du XXIe siècle, un pianiste dont l’œuvre, loin de se limiter à la Suède ou à l’Europe, participe de cette conversation mondiale sur ce que la musique peut être, et pourquoi elle importe.
Thierry De Clemensat
Member at Jazz Journalists Association
USA correspondent for Paris-Move and ABS magazine
Editor in chief – Bayou Blue Radio, Bayou Blue News
PARIS-MOVE, October 4th 2025
Follow PARIS-MOVE on X
::::::::::::::::::::::::
Musician :
Adam Forkelid | Grand Piano
Track Listing :
Dream no. 1: Liminality
Dream no. 2: Unfold
Dream no. 3: Time
Dream no. 4: Repose
Dream no. 5: The Quiet Above
Dream no. 6: Strive
Recorded by Adam Forkelid
Mixed and Mastered by Klaus Schneuemann, 4ohm Berlin.
Photo by Joona Tolvanen
Cover Design by Jonas Holmberg